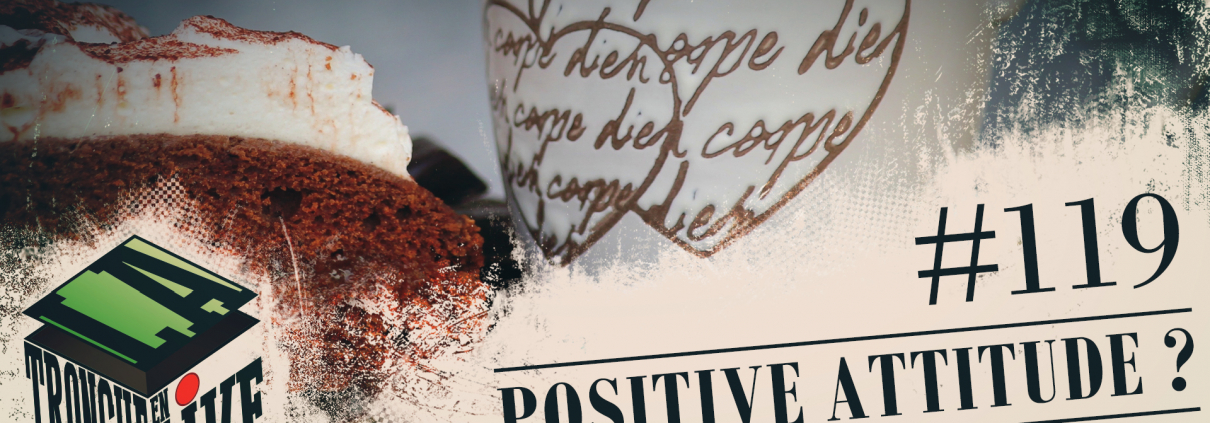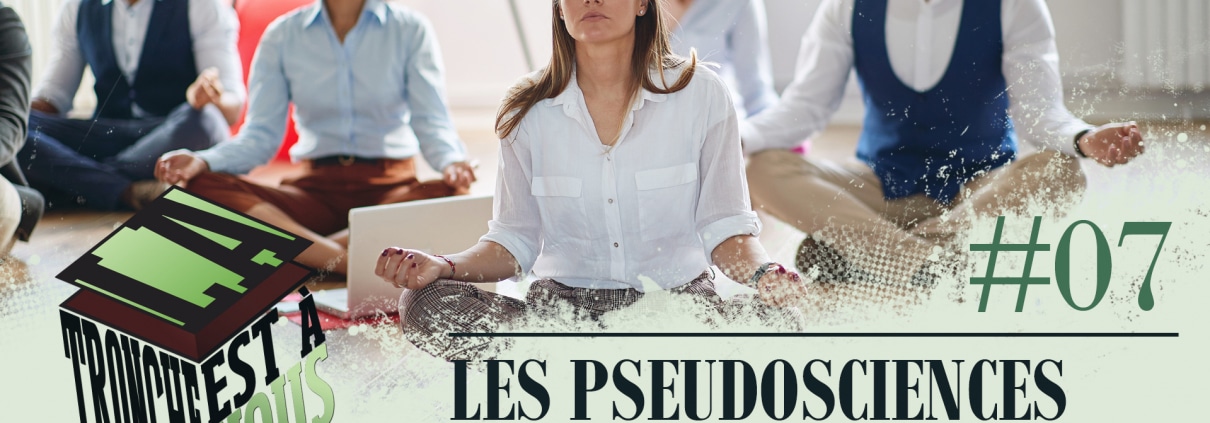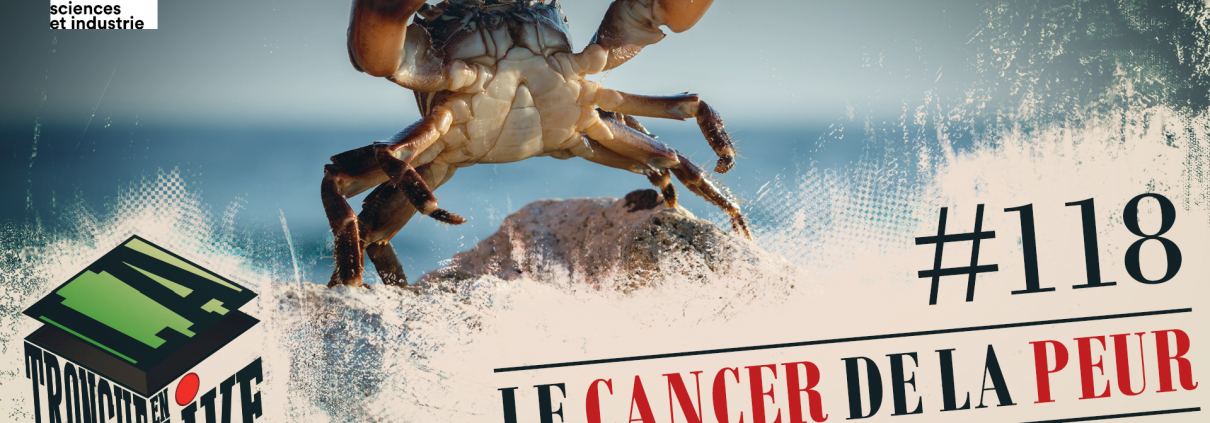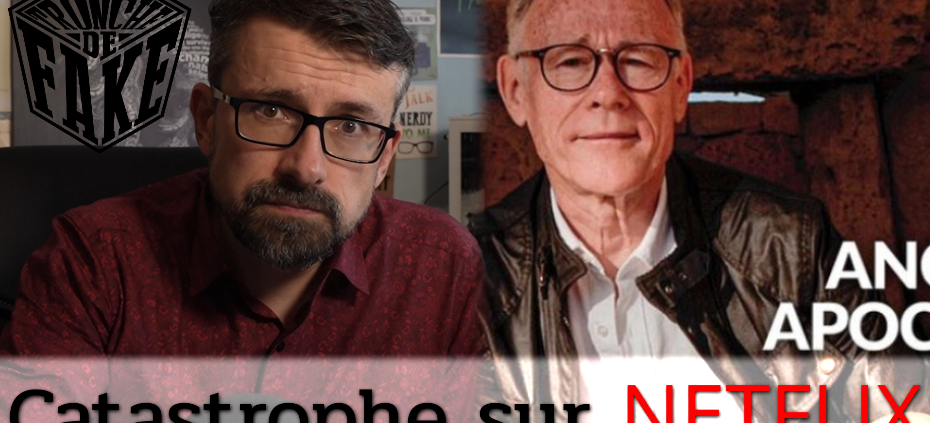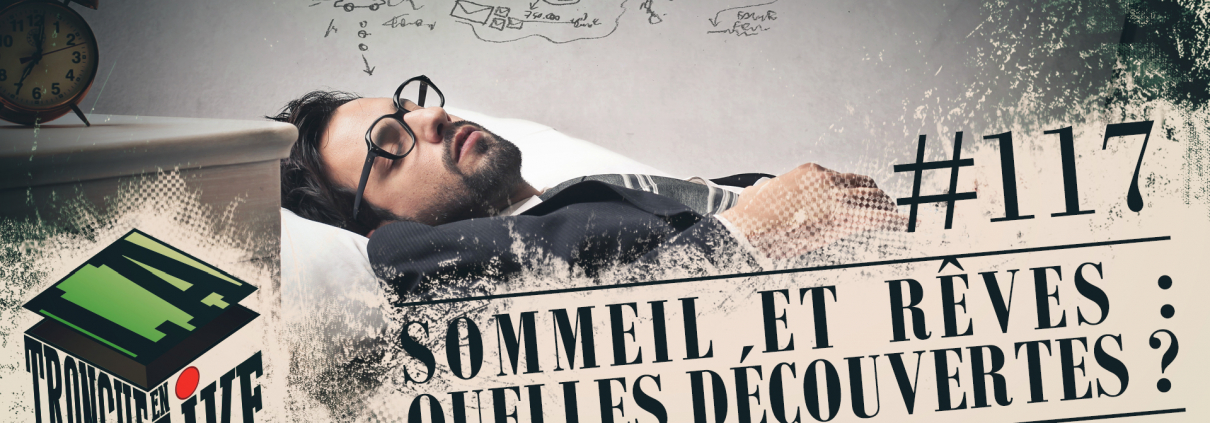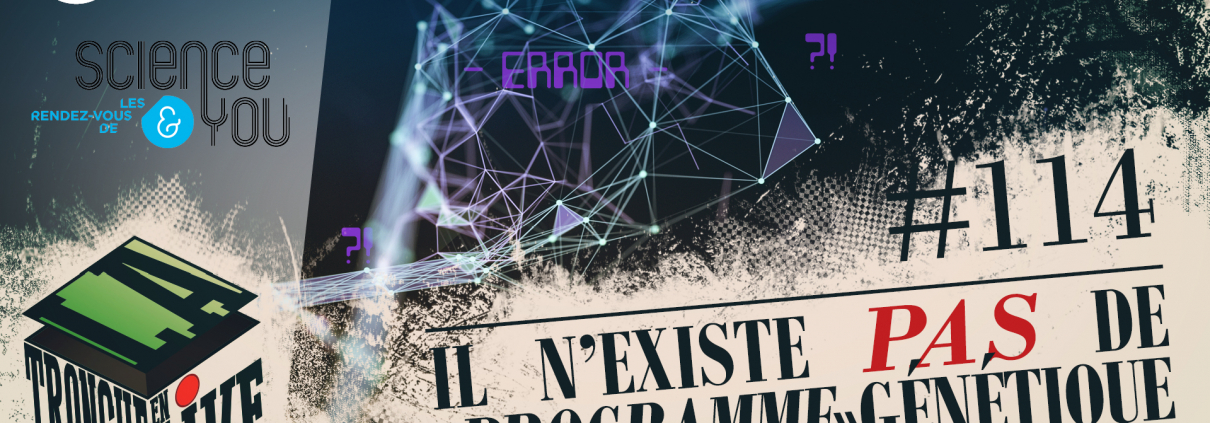Netflix a fait un carton avec la série titrée en anglais « Ancient Apocalypse » et en français « à l’aube de notre histoire » (un titre mollasson, les traducteurs sont mauvais ou un peu gênés par ce qu’on leur demande de faire). Cette série de 8 épisodes met en vedette le narrateur Graham Hancock. Ce succès n’a rien d’étonnant, les livres du monsieur se vendent à des millions d’exemplaires : il raconte des choses intéressantes.
La thèse tient en deux phrases : Notre espèce est amnésique, nos livres d’histoire ignorent complètement une ancienne civilisation de bâtisseurs, anéantie par un cataclysme naturel il y a 12800 ans. Cette ancienne culture peut être retrouvée dans le monde entier sur des sites très anciens qui font référence à des mythes communs que les archéologues ne sont pas foutus de lire correctement parce qu’ils ne veulent pas accepter la vérité découverte par quelques théoriciens marginaux dont Graham Hancock.[1]
Intéressant, non ? Mais tout ce qui est intéressant n’est pas forcément vrai. Ni inoffensif.
Je vais vous divulgâcher l’affaire. Graham Hancock raconte des balivernes, et c’est un homme en colère de ne pas être pris au sérieux par les experts. Il choisit les faits qui l’arrangent, ignore complètement le contexte, les explications déjà fournies, les travaux actuels des experts, les incohérences entre les éléments qu’il rassemble, il amasse une pile de cerises et vend tout ça en répétant ad nauseam que les archéologues se trompent. Il s’agit d’une sorte de trafic de contrefaçon de la préhistoire qui jongle avec le mystère, les effets de dévoilement et un sentiment anti-intellectuel qui aime prendre les universitaires pour des idiots pantouflards aux idées archaïques ou bien des corrompus.
Episode 1 « Ca fait de moi l’ennemi numéro 1 des archéologues.» « L’archéologie n’adhère pas aux nouvelles preuves »
Quand on fait un travail sérieux, on n’a pas besoin de chercher à discréditer les experts : on expose sa démonstration et on attend les critiques.
Nous avons ici rassemblés tous les ingrédients d’une fiction potentiellement sympathique, mais sans le talent et le travail d’un auteur qui pourrait en faire de la bonne fiction. Alors on nous vend tout ça avec une étiquette de science alternative. Et ce qui aurait pu être de la bonne fiction devient de la désinformation. Avec la complicité d’un géant comme Netflix pour financer tout ça et l’injecter dans tous les foyers du monde.
De quel droit il critique, lui ?
Je n’ai aucun intérêt personnel à attaquer ce programme, ni aucun ressentiment envers M Hancock. Quand je croise un programme qui dit des conneries, j’ai envie de dénoncer ces conneries dans l’espoir d’entendre moins de conneries. Je suis certain que vous pouvez comprendre cette motivation.
Quand on critique les récits alternatifs des bonimenteurs sur l’histoire ou sur la science, on se heurte généralement à deux contre-attaques
— La première : Tu n’es pas un expert. Tu n’es pas allé sur place. Ce n’est pas ton domaine Tu n’y connais rien. Tais toi.
— La deuxième, adressée à de véritables experts est : Tu es payé par le gouvernement, ou bien par une grande entreprise, ou bien tu veux vendre tes propre livres : et donc tu as des intérêts à protéger et tu t’attaques à tout ce qui met en danger la version officielle. Alors tais-toi !
On croise toujours. Toujours. L’une de ces deux attaques, voire les deux. Or si vous êtes capable de défendre une seule et même idée avec ces deux contre-attaque, alors vous avez un problème avec la logique et vous ne cherchez pas à savoir ce qui est vrai mais à défendre ce qui vous plait. Il se trouve que la plupart des humains fonctionnent comme ça : l’expertise du camp d’en face nous semble toujours suspecte, beaucoup moins solide que l’expertise du camp des idées que l’on pense vraies. Mais en face ils pensent pareil, alors cet argument n’a en réalité aucune portée, aucune chance de convaincre l’autre ; il ne sert pas à ça. Il est simplement le reflet de notre croyance. Et donc, je suggère de nous en méfier.
Graham Hancock commence son spectacle en insistant sur le fait qu’il n’est pas un chercheur, qu’il est journaliste. Par conséquent, je n’ai pas besoin d’être un expert ou un chercheur, pour réaliser une analyse sur la manière dont il construit son histoire.
« Si la théorie est vraie elle chamboule tout»
–> Oui. Bien sûr. Comme vous le savez déjà : « si c’est vrai, c’est très grave ! » nous disent les complotistes et beaucoup de pseudo-savants détenteurs d’une vérité alternative. Mais avant de dire que c’est grave, que c’est important, que ça chamboule tout, on doit prouver que c’est vrai.
Comment faire ?
Selon toute vraisemblance, vous n’êtes pas un expert en archéologie. Devant un programme qui prétend dévoiler la vérité méconnue sur le lointain passé, je suis comme vous : je n’ai pas les connaissances suffisantes pour détecter à coup sûr ce qui est vrai et ce qui est faux dans la plupart des faits qui vont être présentés. Mais, vous comme moi, nous sommes capables de nous poser des questions et de repérer des incohérences. Quand on n’est pas historien et qu’on n’a qu’une faible connaissance de l’état de la science sur une époque ou un site, on n’est pas réduit à gober ce qu’on entend ou à tout rejeter en bloc. On peut malgré tout évaluer la crédibilité de ce qu’on entend. Mais ça demande quelques efforts et de ne pas se fier à ses seules impressions, sentiments et intuitions.
Source pour reconnaitre un DOCUMENTEUR.
Parcourons le récit
Episode 1
La série démarre à en Indonésie, à Gunung Padang, un site daté du 5e au 2e siècle avant notre ère, notamment grâce à des poteries, mais vieux de 8000 ans pour d’autres. Soit. Mais Graham Hancock veut affirmer que le site date de 24.000 ans. Et qu’il s’agit d’une pyramide. Et que les spécialistes ignorent tout de la civilisation qui l’a construite, qu’ils le vivent mal et préfèrent donc ne pas y croire. A l’appui de ce récit la série nous fournit de très belles prise de vue aérienne faits avec un de drone et des images de synthèse qui reconstituent la pyramide ancienne. Elle est là, devant nos yeux. C’est donc que c’est vrai. Personne ne s’amuserait à dessiner de telles images qui seraient purement nées de son imagination ! Sauf que c’est exactement ce qui se passe.
Sur place le géologue Danny Hillman Natawidjaja adhère à la version de la civilisation perdue, prétend qu’il existe trois chambres secrètes à l’intérieur de ce qu’il appelle une pyramide. Sauf qu’il est la risée du métier pour qui la colline est une colline. C’est exactement ce qui se passe avec l’histoire des « pyramides de Bosnie » défendue par Semir Osmanagic pour des raisons idéologiques nationalistes. Pour cet entrepreneur, la colline de Visoko est la plus grande pyramide du monde : il dirige sur le site des fouilles qui construisent les ruines qu’il prétend découvrir. Et de la même manière le politique s’en mêle, avec le président de l’Indonésie qui approuve les récits de pseudo-histoire qui flattent les idéaux nationalistes.
Pour les archéologues, le site de Gunung Padang est remarquable, il s’agit du plus grand site mégalithique du sud-est asiatique, mais ils rappellent qu’en archéologie on découvre d’abord la culture, on estime l’âge des artefacts, on étudie les cultures avoisinantes, les références, les influences, et ensuite seulement on peut établir la place historique de la construction. Dans la méthode de Graham Hancock, on trouve des choses, on les date au carbone 14 et on invente une culture qui en serait à l’origine[2]. De cette manière, Hancock valide l’idée d’une pyramide vieille de plus de dix mille ans parce que cela l’arrange. Et c’est comme ça, l’affaire est réglée.
Pour cette série Netflix, les primitifs de cette région ne peuvent pas avoir soulevé toutes les lourdes pierres au sommet de la colline, il faut donc que d’anciens sages leur aient appris comment faire en les civilisant. Et s’il ne reste rien de ces anciens sages, c’est parce que leur civilisation a disparu sans laisser de trace. Et s’il ne reste aucune trace c’est parce que le Déluge a tout effacé. Et on est certain que le Déluge a eu lieu puisque beaucoup de cultures dans le monde ont des récits d’inondations catastrophiques qui ne peuvent avoir pour origine qu’un même cataclysme mondial.
Ceci n’est pas une théorie scientifique, c’est un brouillon de script pour un film de Roland Emmerich. Ce n’est pas une démonstration, c’est une monstration : « Regardez là c’est bizarre hein. Et ici comme c’est trop étrange. Personne n’a d’explication, donc j’ai raison ! »
Episode 2
Ensuite Graham Hancock se balade devant la caméra au Mexique. La grande pyramide de Cholula existe. Mais ce n’est pas suffisant pour Graham Hancock qui nous dit qu’elle a été construite par des bâtisseurs anciens ayant reçu l’enseignement d’un sage venu de la mer. Le procédé est identique à celui du 1er épisode. Pas question que les autochtones aient pu faire ça tout seul. Il faut lire dans la statuaire qu’un mystérieux sage est venu de la mer pour enseigner la civilisation à ces gens.
Episode 3
« Tout ce que les archéologues disent sur l’histoire de Malte est faux »[3]. Derechef le même message : les peuple connus par les historiens sont trop primitifs pour être les bâtisseurs des temples qu’on trouve sur l’ile. Et ces temples sont plus vieux qu’on ne le dit. Sur quoi tout cela repose-t-il ? Regardez bien : sur rien. Ce que Hancock ne dit pas c’es que les travaux de datation de ces sites anciens sont multiples et convergents[4].
Pour prouver sa « théorie », Hancock décide de croire que des dents de Neandertal ont été retrouvé sur l’ile, dans la grotte de Ghar Dalam. La littérature scientifique penche plutôt pour des dents d’homme modernes , mais en fait peu importe, parce que posez-vous la question : la présence de Neandertal sur Malte a-t-elle quelque chose à voir avec l’existence d’une civilisation ancienne perdue ? Hancock est-il en train de dire que cette civilisation perdu était celle d’Hommes de Neandertal ?
Episode 4
On s’en va aux Bahamas pour s’étonner de la présence de ce qui ressemble à un mur ou à une chaussée immergée à faible profondeur. Ce serait une construction humaine ! Et ce serait fantastique.. En réalité les géologues ont la réponse. Ce qu’on appelle la Route de Bimini est d’origine naturelle[5]. Ces grès de plage sont le résultat d’un phénomène de sédimentation. D’ailleurs, on ne trouve aucun artefact, aucun outil, ni trace d’outil, que ce soit sur la « route » ou sur les iles voisines ou alentour. Zéro bâtiment monumental. Aucune trace de civilisation. Comment Graham Hancock explique-t-il cela ? Eh bien il ne le fait pas, il n’en dit pas un mot.
Mais plus grave, toute l’opération de monstration est dézinguée par Hancock lui-même qui déclare à la 19e minute :
« Je m’en fiche que la Route de Bimini soit naturelle ou faite par l’homme, ce que je dis c’est que c’est putain de bizarre qu’elle apparaisse sur une veille carte. »
Il fait alors référence à la carte de Piri Reissur laquelle beaucoup de bêtises ont été écrites. On prétend qu’elle montrerait l’Antarctique libéré des glaces, donc à une époque trrrèès reculée. Balivernes. La carte de Piri Reis n’est pas si étrange qu’on voudrait le croire ; à ce sujet, vous pouvez lire l’article Wikipédia[6] et consulter ses nombreuses sources.
On voit ici clairement à l’œuvre la pensée motivée de l’auteur. Il choisit des éléments éparses, les interprète à sa sauce, les relie entre eux, c’est un travail d’imagination digne d’un scénariste, je respecte ça. Mais le faire passer pour une enquête sérieuse pouvant donner des leçons aux archéologues et historiens ? Vraiment, Netflix ?
Episode 5
L’épisode de Gobekli Tepe est intéressant parce que la rhétorique y est clairement défectueuse. On peut le repérer sans avoir de connaissance et sans chercher à vérifier les faits tels qu’ils sont présentés.
On nous explique que la plus grande chambre de Gobekli Tepe est aussi la plus ancienne, et ce serait la preuve qu’il n’y a pas eu de coup d’essai, donc qu’il s’agit d’une œuvre permise par une science venue d’ailleurs. Et cela valide le récit déjà présenté auparavant de la culture supérieure détruite mais transmise via quelques survivants. Mais voilà qu’un peu plus tard on nous révèle que le site contient une vingtaine d’autres enceintes repérées sous le sol mais non explorées et donc non datées. Evidemment, on est en droit de se demander si elles ne pourraient pas être plus anciennes et donc avoir préparé la construction de la grande chambre, ce qui démolit l’argument précédent. Avoir laissé passer une telle auto-contradiction est très révélateur : c’est typiquement le genre d’indice qui doit immédiatement rendre suspicieux.
Episode 6
Je ne vais m’attarder que sur certains points parce que maintenant vous avez compris la méthode employée. Graham Hancock va visiter le site du tumulus du Grand Serpent dans l’Etat de l’Ohio, mais il n’est pas autorisé à y installer son équipe de tournage alors il fait un caca nerveux sur le parking et crie à la censure, comme si le filmer en train de crapahuter sur le site, comme on le voit faire en mode carte postale dans les autres épisodes, était indispensable à son message. La censure consiste à empêcher un auteur de partager ses idées, ses travaux. Pour Hancock, qui parle sur Netflix à des millions de gens, la censure c’est lui dire : non, vous ne pouvez pas emmener votre équipe de tournage sur ce site amérindien pour dire devant une caméra que tous ceux qui travaillent ici mentent au public.
Le grand Tumulus du serpent est digne d’intérêt. Il n’est pas construit n’importe comment mais présente un alignement avec le ciel. En soi c’est banal. Même nos maisons sont construites en tenant compte de l’ensoleillement. Mais Hancock nous réserve une surprise
« On le date de [telle époque] mais c’est sûrement une reconstruction, car le Serpent est connu pour changer de peau. »
La méthode de Hancock se révèle dans toute sa splendeur : le vertige des analogies, la magie des symboles, l’imagination débridée. Graham Hancock voudrait ce ce site date de l’époque du cataclysme dont il veut nous montrer l’existence, alors il décide que cette construction n’a de sens que si on suppose qu’elle a été faite il y a douze mille ans. Bien sûr, tel un astrologue, il trouvera des alignements pertinents à l’époque voulue, et estimera que ça prouve qu’il a raison. Et peu importe ce qu’en pensent les experts du site. De toute façon ce sont de vilains censeurs.
Episode 7
Je vais résumer cet épisode à une citation de Graham Hancock.
« Ne vous fiez pas aux experts. Faites vos propres recherches. »
Cela n’empêche pas notre homme de convoquer des gens qu’il présente comme des experts pour valider son propos. Il faut visiblement se fier aux experts qui sont d’accord avec lui, ou qui au minimum opinent devant une caméra, même si après coup, ils regrettent qu’on ait instrumentalisé leur parole. Comme c’est le cas de l’archéologue maltaise Katya Stroud, qui explique être en désaccord avec le contenu du programme et que sa parole a été dénaturée, tronquée et citée hors contexte. Bref, l’experte choisie par Graham Hancock nous dit que le programme est malhonnête[10]. C’est probablement la pire critique qu’un documentaire puisse recevoir.
Episode 8
À la fin de cette série, on nous résume l’histoire. Une comète a frappé la terre, a provoqué une période hivernale catastrophique qui correspond au Dryas récent, une époque géologique déjà décrite par les paléontologues. Et cet événement a détruit une grande civilisation dont les survivants sont allé transmettre leur savoir aux pauvres sauvages du reste du monde. Cette histoire, c’est celle de l’Atlantide telle qu’Ignatus Donnelly nous la raconte en 1882[7]. Graham Hancock ne fait que reprendre cette légende qui servait à dénier les réalisations des peuples natifs du continent Américain. Les anciens sites d’Amérique venaient forcément d’un autre peuple, supérieur, blanc. Je vais y revenir.
Habile Marketing
La série de Hancock est habile. Elle va plaire à beaucoup de gens qui ont des idées très différentes, parce que si vous regardez bien, le tour de force narratif de ce programme est le suivant : il ne dit RIEN sur la civilisation ancienne dont il prétend nous révéler l’existence !
À quoi ressemblaient ces humains ? Quelle langue parlaient-ils ? Quel niveau de technicité, de technologie possédaient-ils ? Sur leur couleur, leur culture, leur ethnie… Pas un mot. Et ça c’est formidable. Si vous voulez croire à une race supérieure oubliée, ça marche. Si vous voulez croire à une visite extraterrestre, aux Elohims un à n’importe quel mythe antédiluvien, c’est open bar. Et le titre Ancient Apocalypse nous rappelle Ancient Aliens (« Alien theory » pour le titre anglophone destiné aux marché français), un programme complètement débile qui en est à sa 18e saison. Je connais des chercheurs qui aimeraient avoir le budget de ces producteurs pour faire de la vraie science ou des programmes qui informent et éduquent au lieu d’hypnotiser.
Hancock ne prend pas le risque de déstabiliser son public. Il ne contredit aucune des thèses farfelues des pseudo-historiens. Il se contente de taper sur la position du monde académique. Il n’appelle même plus Atlantide l’ancienne civilisation de son récit (alors que de là que tout part !). Il est donc plébiscité par tout un tas de gens dont les croyances sont incompatibles mais ont un point commun : le rejet de l’état des connaissances scientifiques sur la base d’un sentiment personnel d’une vérité plus grande, plus impérieuse. Le principal pour eux, c’est d’avoir un programme grand public qui semble aller dans leur sens.
Graham Hancock était moins habile dans le passé. Dans les premières éditions de ces livres, avant 1995, l’ancienne civilisation dont il parle tout le temps était… blanche[8]. Le peuple ancien, l’origine de la civilisation, ce sont des blancs. Il fallait des blancs pour apprendre aux sauvages du monde comment construire des temples, faire des mathématiques ou de l’agriculture. Et en réalité c’est ça la grande différence d’avec l’histoire réelle : la place des blancs. Mais Hancock ne le dit plus parce que le public qui y croit déjà n’a pas besoin qu’on le lui rappelle explicitement, il le comprend. Et, bien sûr, il aurait plus de mal à passer sur Netflix s’il versait ouvertement dans le suprémacisme.
Cette théorie est suprémaciste car elle a permis aux colons banc de considérer que les autochtones n’avaient rien accompli par eux-mêmes et n’avaient construit aucun des grands tumulus américains. Sur cette base, on a nié leur droit sur les territoires qu’ils occupaient. On ne peut pas passer sous silence la tradition raciste qui accompagne ces récits depuis près de cents cinquante ans. Cela fait partie des motivations de ceux qui y participent et c’est clairement la couleur idéologique des réseaux qui en font la promotion.
Que disent les experts ?
5.1— Lettre de la Society for American Archaeology[9] ,
Le président de la SAA, forte de 5500 membres, a envoyé un courrier aux dirigeants de Netflix.
« La série dénigre les archéologues et leur profession sur la base d’affirmation fausses et de désinformation. (…) Nous avons trois problèmes principaux avec « Ancient Apocalypse »:
(1) — l’hôte de la série rabaisse violemment les archéologues et la pratique de l’archéologie avec une rhétorique agressive, cherchant délibérément à nuire à nos membres et à notre profession aux yeux du public.
(2) — Netflix présente le programme comme une « docu-série », un genre qui implique que son contenu est fondé sur des faits, alors que l’émission est basée sur de fausses affirmations sur les archéologues et l’archéologie.
(3) — la « théorie » présentée est depuis longtemps associée aux idéologies racistes et suprématistes blanches, elle traite injustement les peuples autochtones ; et encourage les extrémistes. »
Sur la charge idéologique de ce programme : « The assertions Hancock makes have a history of promoting dangerous racist thinking. His claim for an advanced, global civilization that existed during the Ice Age and was destroyed by comets is not new. This theory has been presented, debated, and refuted for at least 140 years. It dates to the publication of Atlantis: The Antediluvian World (1882) and Ragnarok: The Age of Ice and Gravel (1883) by Minnesota congressman Ignatius Donnelly. This theory steals credit for Indigenous accomplishments from Indigenous peoples and reinforces white supremacy. From Donnelly to Hancock, proponents of this theory have suggested that white survivors of this advanced civilization were responsible for the cultural heritage of Indigenous peoples in the Americas and around the world. However, the narratives on which claims of “white saviors” are based have been demonstrated to be ones modified by Spanish conquistadors and colonial authorities for their own benefit. These were subsequently used to promote violent white supremacy. Hancock’s narrative emboldens extreme voices that misrepresent archaeological knowledge in order to spread false historical narratives that are overtly misogynistic, chauvinistic, racist, and anti-Semitic »
Que vaut cette histoire ?
Graham Hancock n’aime pas la science. Il n’apporte aucune démonstration scientifique. Et c’est logique. Il est féru de métaphysique, et il déroule un récit qui ne s’appuie que sur une collection d’interprétations personnelles de quelques sites anciens et une sorte de vérité intérieure. Hancock est le prédicateur d’une religion New Age héritée de la théosophie, qui n’essaie jamais de peser le pour et le contre dans les faits allégués mais choisit constamment où se trouve la vérité en dénigrant les « soi-disant experts » qui ne pensent pas comme lui. Il faudrait le croire parce qu’il est marginal, parce qu’il défend une version de l’historie non admise par les experts. Le processus de victimisation appelé Syndrome de Galilée est à l’œuvre : je suis seul à dire ce que je dis, on me contredit. C’est parce que la vérité fait peur. Rappelons nous que lorsqu’un homme isolé contredit tous les experts du monde, c’est plutôt en soi un excellent indice qu’il a clairement tort.
Dans une conférence TED de 2013, Graham Hancock explique que pendant 24 ans il a été presque en permanence défoncé au cannabis[11], ce qui l’a beaucoup aidé dans son travail d’auteur. Il a arrêté le cannabis quand il a commencé l’ayahuasca. Je ne dis pas que ce programme est le résultat d’un délire de drogué, mais… à la vérité je me demande ce qui empêcherait de le dire. La manière dont l’auteur traite son cerveau et les moyens par lesquels il s’approche de la vérité nous renseignent sur la confiance qu’on peut accorder à ses hypothèses.
« L’ancienne apocalypse pourrait se répéter»
Je finirai avec un jugement personnel. On a le droit d’émettre un jugement sur ce qu’on vient d’analyser aussi longuement, cela ne veut pas dire que l’on délivre une vérité définitive. Selon moi, un tel programme ne peut pas aider les spectateurs à évaluer correctement leur niveau de confiance envers les sources les plus fiables. Graham Hancock et Netflix nous apprennent à nous méfier de la science et à nous réfugier dans les bras des baratineurs. Cela ne peut pas avoir des conséquences heureuses pour l’humanité. On ne devrait jamais faciliter la production et la diffusion de tels contenus. Ils font du mal. Où sont les productions Netflix qui aideraient le public à ne pas se faire avoir pas de tels fantasmes ?
Boite à outil
Notre meilleur moyen d’éviter de croire n’importe quoi, c’est le questionnement. Voici les questions que je propose de se poser lorsqu’on est face à un contenu de ce type.
- L’auteur est-il un spécialiste du sujet ?
- [On peut être un amateur éclairé et avoir des propos de haute qualité. Mais l’avantage d’être un spécialiste qui publie des travaux scientifique c’est qu’on a la preuve que d’autres experts estiment le travail valable. ]
- L’auteur donne-t-il les sources de ses propos pour que l’on puisse aller vérifier les faits et la manière dont ils sont compris par les experts des domaines concernés ?
- L’auteur donne-t-il un avis personnel ou fait-il appel aux connaissances établies ?
- Le récit a-t-il une résonance idéologique ?
- Que disent les experts de ce travail ?
- Assiste-t-on à une démonstration ou à un scénario s’appuyant sur des éléments disparates ?
- Le récit est-il totalement cohérent ? Le choix des éléments et événements utilisés pour faire la démonstration est-il justifié ?
- L’interprétation des fait laisse-t-elle de la place aux hypothèses alternatives ? Explique-on pourquoi ces alternatives ne sont pas convaincantes ?
- La méthode permettant de mettre à l’épreuve le récit proposé est-elle soulignée, mise en avant ou au contraire disqualifiée ?
- L’auteur a-t-il un intérêt personnel (pécuniaire, idéologique, symbolique) à faire croire à son histoire ?
- Hancock a une longue et lucrative carrière d’auteur d’histoire alternative derrière lui, et il tient à promouvoir une certaine spiritualité.
Je finirai avec le conseil donné par l’archéologue John Hoopes [12] à ceux qui veulent se renseigner sur les sites anciens
« Curieusement – et je sais que les journalistes pourraient se hérisser à ce que je dis – Wikipédia est la meilleure source. Il est maintenu par des nerds, et les parges liées à l’archéologie sont maintenu par des nerds en archéologie. Les articles à ce sujet sont bons ! J’ai le sentiment qu’ils s’amélioreront encore grâce à cette série, car les gens voudront s’assurer que les informations soient là pour les téléspectateurs qui feraient des vérifications. »
Acermendax
_______________
Références
[1] Il expose sa théorie à 30 min de l’épisode 1.
[2] Source : https://www.smh.com.au/world/digging-for-the-truth-at-controversial-megalithic-site-20130726-2qphb.html
[3] https://timesofmalta.com/articles/view/maltese-archaeologists-push-back-netflix-show-s-temple-claims.995910?fbclid=IwAR0HJS0S8s9TyU2Wu1o3e82yioF-GuzezEB-OvB9wu3DWei4mhaLpoMGrgw
[4] https://ahotcupofjoe.net/2022/11/graham-hancocks-ancient-apocalypse-a-review-of-episodes-three-and-four/
[5] https://actugeologique.fr/2022/12/pas-de-vestige-de-latlantide-pres-des-iles-de-bimini/?fbclid=IwAR2v15twJSQFVoFXrcDxZTFF6j09LI2kromP4yc1r9JcjdD30P5QimFXMro
[6] https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_Piri_Reis
[7] https://www.jasoncolavito.com/ragnarok-the-age-of-fire-and-gravel.html
[8] https://boingboing.net/2022/11/27/archaeologists-reveal-the-white-supremacist-nonsense-behind-netflixs-ancient-apocalypse.html
[9] http://www.saa.org/quick-nav/saa-media-room/saa-news/2022/12/01/saa-sends-letter-to-netflix-concerning-ancient-apocalypse-series
[10] https://actugeologique.fr/2022/12/pas-de-vestige-de-latlantide-pres-des-iles-de-bimini/?fbclid=IwAR2v15twJSQFVoFXrcDxZTFF6j09LI2kromP4yc1r9JcjdD30P5QimFXMro
[11] https://www.youtube.com/watch?v=Y0c5nIvJH7w
[12] Source : https://slate.com/culture/2022/11/ancient-apocalypse-graham-hancock-netflix-theory-explained.html?fbclid=IwAR3FosO7Gf3XjQc-fkw-FnZ-Z02F3KLsQb-c2aIFNKe0tyixsX78POQYTeA
Ressources
— Le site d’IRNA.
— Une critique en Français de Ancient Apocalypse, publiée ce matin dans Le Devoir (Montréal) par un collègue, directeur du département d’anthropologie de l’Université de Montréal.
— The Ancient Absurdities of Ancient Apocalypse [Slate].
— Critique par des archéologues français [20 minutes]
— Article sur la préhistoire de Malte. Et sur la Route de Bimini.
— Pour The Guardian, il s’agit du programme le plus dangereux de Netflix.
— « Netflix’s ‘Ancient Apocalypse’ is more fiction than fact, say experts »
—