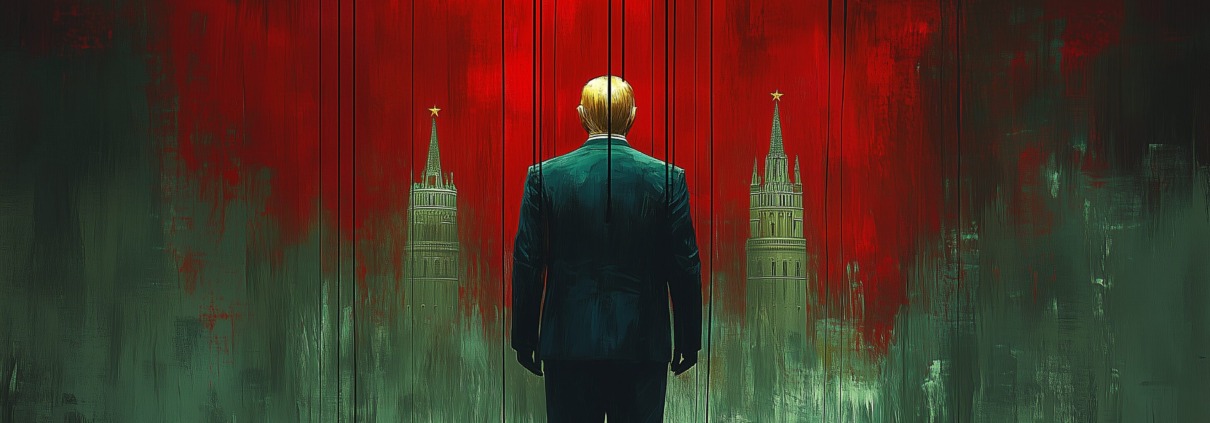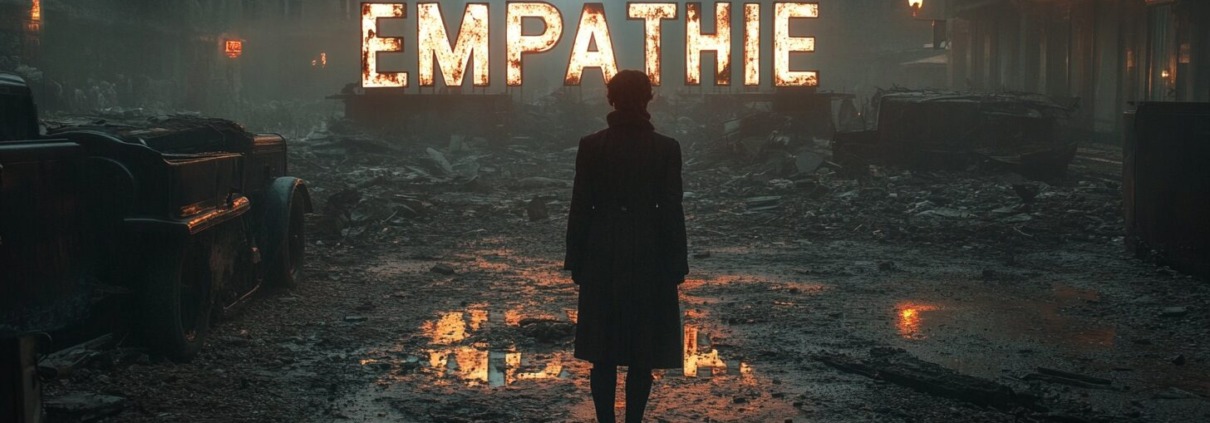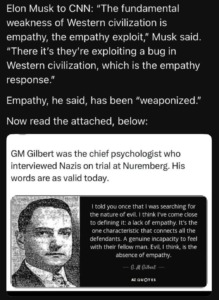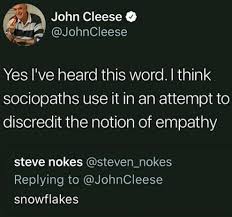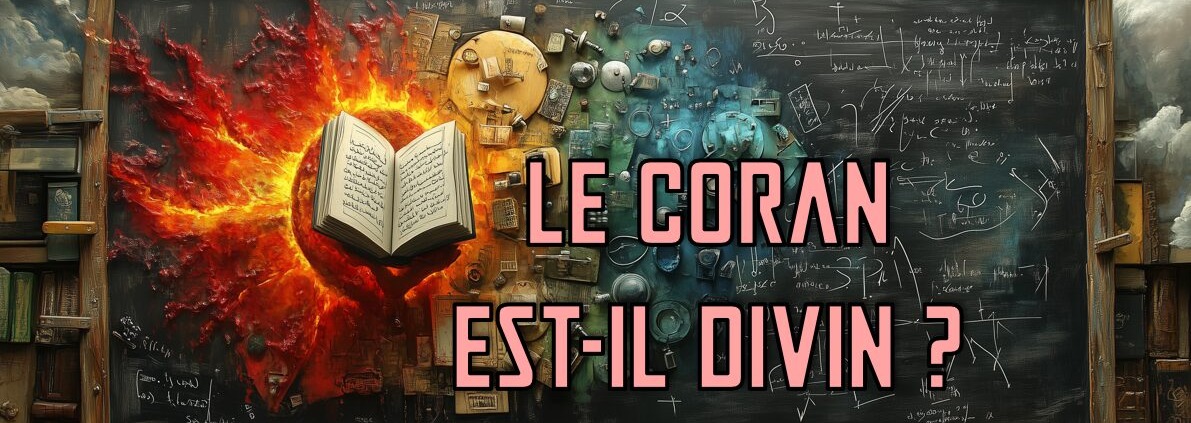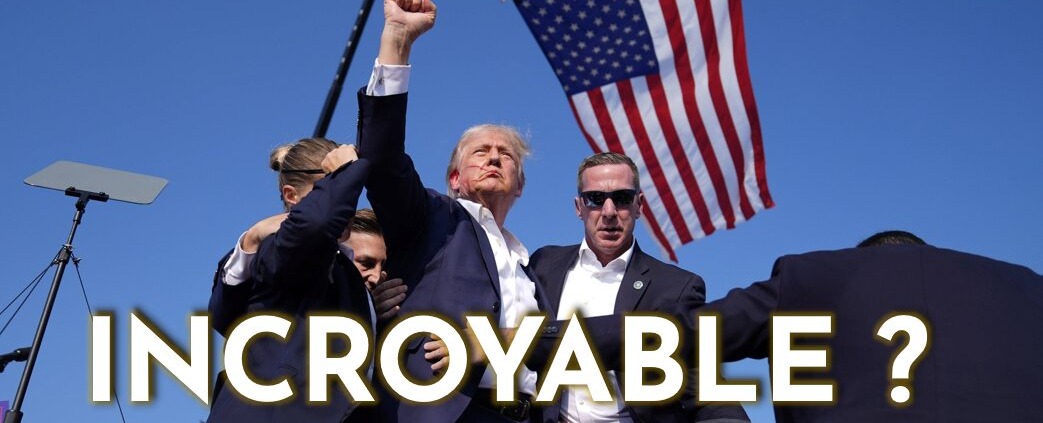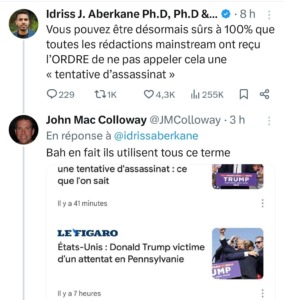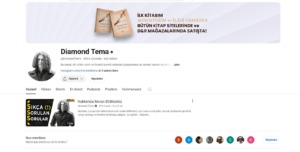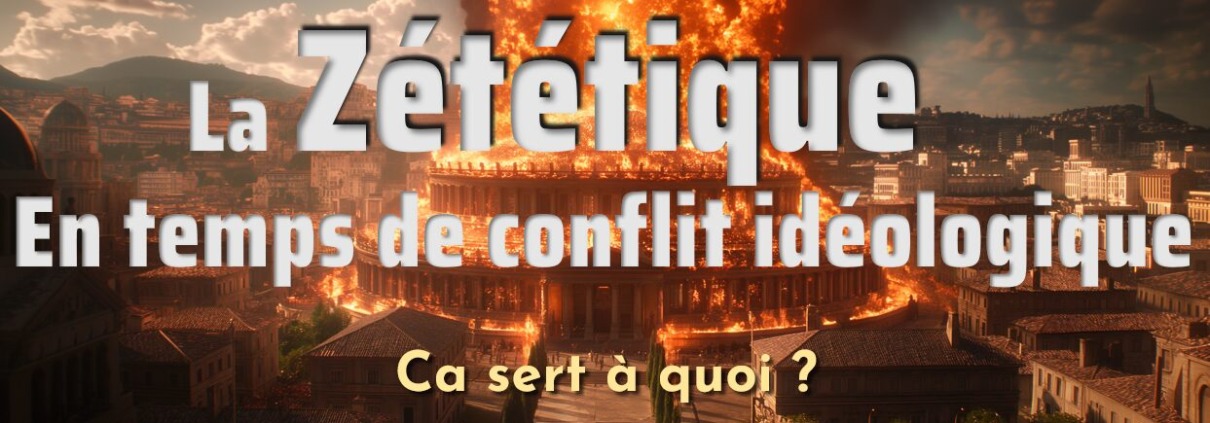Dans le cadre de mon débat du 9 décembre 2024 avec Ousmane TIMERA, je me suis penché sur les prétentions des islamologues qui vénèrent le texte du coran en lui-même en ce qu’il serait incréé et parfait : divin.
Pour les besoins du débat, je ne pouvais me contenter de lancer le défi « Prouvez-moi que ce texte est divin » et laisser à mon interlocuteur tout le loisir de nous promener dans un prêche interminable. J’ai donc choisi de proposer des critères qui seraient testables afin de mettre le texte à l’épreuve. Le cadre du débat ne m’a pas permis d’aborder tous les points que je voulais traiter. La vidéo du débat vous permettra de constater que la conversation n’a pas été fluide, je n’ai jamais obtenu aucune réponse à mes questions. C’est pourquoi, je crois donc avoir été judicieux dans mon choix de réaliser une sorte de démonstration, de débunkage en présentant une manière de défendre le Coran et sa confrontation au réel.
Voici le document de travail que j’avais sous les yeux pendant la deuxième partie du débat.
Transition — de Dieu au texte
Il existe beaucoup de raisons, de motifs, de mobile pour croire en Dieu. Ces raisons se cachent dans l’histoire de l’espèce humaine, dans la sélection de biais cognitifs qui nous conduisent à percevoir des choses qui ne sont pas là, comme par exemple un visage dans un nuage : ça n’arrive pas par hasard. Il existe des explications anthropologique, sociologiques sur le besoin de codifier les rapports humains, d’établir une autorité pour garantir des rapports pacifiés. Et puis le temps et la culture ont façonné des récits qui mélangent tout un tas d’explications, et qui fournissent aux humains une carte mentale qui leur permet de se situer par rapport aux autres. Le résultat c’est la présence de la croyance en Dieu dans quasiment toutes les cultures. Et ces raisons n’ont rien à voir avec les arguments apologétiques rencontrés dans ce genre de débat, parce que les apports des sciences sociales et psychologiques dérangent profondément les théologiens et les apologètes : ils ont un intérêt très net à les ignorer.
La science ne rapproche pas de Dieu, les statistiques sont claires. Mais on peut très bien avoir en soi un sentiment, un élan, quelque chose qui incite à croire en une forme de transcendance. C’est très humain et ça ne pose aucun problème. Les athées ne devraient pas avoir vocation à interdire aux gens de croire. Mais le débat de ce soir ne porte pas sur un sentiment intime de connexion à une entité inaccessible et inconnue, nous discutons de la possibilité que l’Islam dise la vérité, ce qui a des conséquences bien plus profondes, plus graves, que la simple croyance déiste en un créateur.
Cela implique que Dieu existe (alors même que dans toutes nos connaissances, rien ne l’indique, rien ne le prouve) mais il faut encore que les anges existent. Il faut que l’enfer existe. Il faut que Dieu ait choisi de parler à des prophètes tout en se cachant aux yeux des autres. Il faut que Dieu ait choisi que sa parole soit découverte, diffusée et comprise à travers un texte : le Coran, révélé en plein désert à un homme illettré qui va devenir gourou et seigneur de guerre ; un texte réputé définitif, indépassable, valable jusqu’à la fin des temps, un texte parfait, inimitable, car divin.
C’est notre deuxième thème : le coran est-il divin ?
D’emblée je suis face à une difficulté, car je ne sais pas définir ce qui serait divin, je ne manipule pas de tels concepts dans mon paradigme. Mais je ne suis pas venu pour refuser de débattre, alors je pense qu’il faut se référer aux critères que le coran fournit lui-même. Si le coran est divin, il doit être parfait, inimitable et ne contenir aucune erreur. Le coran le dit lui-même !
En tout logique la proposition « Le coran est divin » est réfutée à la seconde où l’on y trouve un passage qui montre une imperfection. On peut très bien admettre, si l’on veut, qu’il existe dans ce texte des passages formidables, superbes, plus beaux que tout ce qui a été écrit. Si en même temps on trouve une incohérence, une erreur, ou même un passage inutile, alors nous ne sommes plus en présence d’un texte parfait. Or, sans suspense, en termes d’imperfection on pourrait faire des listes à la Prévert : esclavage, guerre sainte, maltraitance des femmes, mariage des petites filles, récits de miracles farfelus, versets sataniques, versets abrogés après la mort du prophète, etc. La plupart des non-croyants voient sans aucune difficulté toutes ces imperfections, mais c’est difficile quand on commence par croire, quand on est élevé dans la foi, d’accepter de faire marcher son esprit critique. C’est normal de trouver insupportable que quelqu’un comme moi se permette de pointer du doigt ces gros problèmes. Mais quand on est adulte, il faut faire avec.
Pour tester l’hypothèse « le coran est divin », on pourra chercher des erreurs et incohérences, ce sera l‘objet de la discussion, mais je vais faire plus que cela : je vais vous dire, ce que j’attends, moi, d’un texte divin, donc émanant d’une entité omnisciente, toue puissante et infiniment bonne.
Voici mes critères
- La clarté — Le texte divin met son lecteur dans l’impossibilité de le comprendre de travers et de l’utiliser pour faire le mal. Il ne contient pas de verset équivoque. Il commande les croyants à être attentifs au bien-être de chaque être sensible, par exemple.
- La préscience — Le texte divin contient de manière explicite (et claire !) des informations impossibles à connaître au moment de sa rédaction. (Je peux développer)
- L’universalisme — Le texte divin parle à tout le monde, il est accessible sans intermédiaire, compréhensible sans chef spirituel, résistant aux erreurs de traduction.
- La force — Le texte divin n’a besoin d’être défendu par personne, car il sait convaincre le lecteur par lui-même. (Les grands romans savent faire ça très bien)
- L’amour — Le texte divin ne contient pas des phrases expliquant que Dieu a lui-même fermé le cœur ou les yeux des mécréants pour les empêcher de croire, ce qui implique qu’ils ne sont pas responsables de leur incroyance, tout en promettent quand même de les envoyer dans le feu et en autorisant à les tuer s’ils ne se soumettent pas.
- L’amour, encore — Le texte divin ne codifie pas les châtiments corporels et les mises à morts des humains que son texte échoue à convaincre.*
- [Lors du débat, ici j’ai parlé du châtiment mortel infligé aux homosexuels qui n’est pas explicitement écrit dans le Coran, même s’il est consensuel parmi les islamologues et pratiqué quand règne la charia. Je fait cette modification pour en revenir au texte du Coran et à rien d’autre, c’est l’objet du débat]
- L’amour, une fois de plus — Le texte divin ne fait pas des femmes des êtres inférieurs, soumis aux hommes, et qu’on peut frapper et épouser sans leur consentement dès l’âge de 6 ans.
- L’amour et la bonté, toujours — Le texte divin ne multiplie pas les menaces contre les incroyants, et même contre les croyants en répétant environ 70 fois « craignez Allah ».
Ce sont quelques exemples. Bien sûr, je ne saurais écrire, moi-même, un texte parfait. Mais comme presque tout le monde, je sais reconnaître un texte imparfait.
L’hypothèse gourou
Le Coran est un texte qui contient exactement les connaissances disponibles au moment où il a été inventé par des humains au 7e siècle. C’est d’une grande banalité : aucune phrase n’aurait pas pu être prononcée par un contemporain quelconque du prophète. Aucune découverte scientifique n’a été faite en lisant le Coran. Mais quand les découvertes sont faites il devient très facile de réinterpréter un passage et de scander que tout était déjà écrit dans le Coran comme d’autres croient aux prophéties de Nostradamus. C’est le même niveau de ridicule.
Le Coran, est le texte d’un gourou qui exige l’obéissance, qui fait la guerre, qui rançonne, qui aime l’argent, qui exécute ou ordonne qu’on tue ses ennemis, qui revendique de posséder des femmes, qui justifie qu’on épouse des petites filles. C’est un texte qui contient des fables ridicules comme le miracle de la lune fendue par Mohammed et qui codifie ce que vous devez faire avec vos esclaves sans jamais à aucun moment énoncer le commandement qu’il ne faut pas posséder un autre humain. Le coran pense à interdire la viande de porc, mais pas l’esclavage. C’est un texte dont la version actuelle n’est pas celle qui existait du temps du prophète. Comme tous les textes religieux importants, il a été remanié au gré des besoins de ceux qui avaient le pouvoir de le modifier. (Je développerai ce point)
Le coran existe, c’est un recueil de textes qui remontent à 1400 ans. Et l’objet de notre débat est de comparer deux hypothèses :
- C’est un texte incréé (quoi que cela puisse vouloir dire) descendu directement du Créateur de l’Univers via l’ange Jibril ; il est parfait et doit régir la vie de tous les hommes sur Terre. Un texte divin.
- C’est un texte religieux comme il en existe des centaines, construit par un chef spirituel au gré de ses besoins, avec une période paisible et une période guerrière dont les versets sanglants abrogent malheureusement les versets pacifiques qui les ont précédés ; le texte ne contient rien de plus que ce que les hommes de cette époque savaient sur le monde ; sa moralité périmée est celle du 6e siècle. Un texte humain.
Après 1400 de présence sur Terre, le Coran n’a toujours pas convaincu la grande majorité des humains. C’est parfaitement cohérent avec l’hypothèse d’un texte humain Si vous croyez à un texte divin, vous devez conclure que Dieu n’a pas su adapter son message aux créatures auxquelles il était destiné. Le texte divin qu’on a imposé essentiellement par la guerre, n’est pas convaincant. Allah a échoué à convaincre ses lecteurs ; cela rappelle le principe du peer reviewing en science : quand votre texte n’est pas convaincant, il est rejeté.
C’est la fin du texte par lequel je présentais la thèse sceptique / naturaliste / rationaliste / humaniste dans laquelle je me reconnais. Ci-dessous vous trouverez les notes permettant d’illustrer, démontrer, développer cette thèse.
— Le Coran est-il inimitable ? —
L’une des idées les plus martelée par les apologètes de l’Islam, est la nature miraculeuse du Coran. Il est affirmé que ce texte ne peut pas avoir été écrit par un humain. On en veut pour preuve que le Coran contient plusieurs verset qui le revendiquent explicitement et mettent au défi les infidèles d’imiter le coran.
Coran 17:88: Dis: « Même si les hommes et les djinns s’unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s’ils se soutenaient les un les autres ». (Pré-hég. nº 39)
Coran 10:38: Ou bien ils disent: « Il l’a inventé? » Dis: « Composez donc une Sourate semblable à ceci, et appelez à votre aide n’importe qui vous pourrez, en dehors Dieu, si vous êtes véridiques ». (pré-hég. n°51)
Coran 11:13 : Où bien ils disent: « Il l’a forgé [le Coran] » – Dis: « Apportez donc dix Sourates semblables à ceci, forgées (par vous). Et appelez qui vous pourrez (pour vous aider), hormis Dieu, si vous êtes véridiques ». (Pré-hég. nº 52)
Coran 2:23 : Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à Notre Serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, (les idoles) que vous adorez en dehors de Dieu, si vous êtes véridiques. (Post-Hég. nº 8i7)
Pour certains croyants, cette assertion suffit : c’est vrai puisque c’est dans le Coran. Aux islamologues qui entendent débattre de la question, il faudrait réussir à obtenir des réponses claires à ces questions simples : Comment décide-t-on si quelqu’un a réussi à « imiter le coran » ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Quels sont les critères ? Qui prononce le verdict ?
Je crois pouvoir mettre le monde entier au défi en affirmant que l’œuvre de Terry Pratchett est inimitable, que l’œuvre de des Bee Gees est inimitable, que l’œuvre de Cabu est inimitable. Si je ne donne aucun critère, et si je me réserve le droit de désigner les juges, le monde restera en échec.
Et pourtant il existe de vraies bonnes raisons de penser que le Coran est tout à fait imitable. Et les spécialistes le savent parfaitement.
Argument 1
L’un des scribes de Mohammed, chargés d’écrire les révélations du Coran, Abdallah Ibn Sa’ad Ibn Abî as-Sarh a commencé à douter de l’authenticité des révélations de Mohammed lorsqu’il a remarqué que le prophète acceptait ses suggestions de modifications des versets. L’incident le plus notable s’est produit lorsqu’Abdallah a complété un verset avec ses propres mots, que Mohammed a ensuite acceptés comme faisant partie de la révélation. Cette expérience a conduit Abdallah à renoncer à l’islam et à fuir à La Mecque, affirmant qu’il pouvait produire des révélations similaires à celles de Mohammed. On voit ici qu’il était possible d’imiter le Coran avant même qu’il soit terminé ! Cela fait donc bien longtemps que le défi a été relevé.
Et d’ailleurs, Mohammed le savait sans doute. C’est pour cela qu’il est répété plusieurs fois que toute imitation est impossible ; Mohammed avait besoin que cela soit dit et bien compris.
D’ailleurs, remarquez la suite de la Sourate 2, verset 23-24 : « Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à Notre Serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, (les idoles) que vous adorez en dehors d’Allah, si vous êtes véridiques. Si vous n’y parvenez pas et, à coup sûr, vous n’y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu’alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. »
À ceux qui tenteraient de relever le défi, le Coran de Mohammed explique qu’ils doivent s’attendre purement et simplement à une mise à mort. Pas très fairplay.
Argument 2 : Les versets sataniques
Selon la tradition, le prophète aurait récité des versets autorisant le culte d’autres divinités que Allah, avant de se rétracter en affirmant que ces versets lui avaient été inspirés par Satan. Cet incident aurait eu lieu alors que Mahomet tentait d’établir le monothéisme à La Mecque et faisait face à l’hostilité des polythéistes locaux
Cette histoire soulève plusieurs problèmes pour l’apologétique islamique. Elle montre que même Mahomet n’a pas pu distinguer immédiatement les paroles divines des paroles sataniques, remettant en question l’infaillibilité prophétique. Si le prophète lui-même a été trompé, cela implique qu’aucun lecteur ordinaire ne peut prétendre distinguer avec certitude les versets authentiques des versets potentiellement corrompus. Cet épisode contredit l’idée que le Coran est simple à comprendre et que son interprétation est aisée pour les savants religieux. Si même le prophète a pu être induit en erreur, comment des interprètes ultérieurs pourraient-ils prétendre à une compréhension parfaite ? L’incident remet en question la fiabilité du processus de révélation et de transmission du Coran, puisqu’il montre que des éléments non divins ont pu s’y glisser, même temporairement.
Nous constatons que pendant un certain temps le Coran a contenu des propos inspirés par le diable sans que personne ne les détecte et ne les dénonce. Ni Mohammed ni les croyants, n’ont fait la différence. Ces versets étaient une imitation.
Argument 3 : Des sourates bien imitées ou un Coran falsifié ?
Selon certaines sources chiites, deux sourates auraient été supprimées du Coran officiel :
- La sourate « Al-Wilaya » (L’Autorité) :
Cette sourate aurait fait explicitement référence à Ali et à son statut de successeur légitime de Mahomet. Elle aurait mentionné l’autorité divine accordée à Ali et à sa descendance.
- La sourate « An-Nurayn » (Les Deux Lumières) :
Cette sourate aurait fait référence à Mahomet et Ali comme étant les « deux lumières ». Elle aurait également mentionné l’engagement envers Ali et les conséquences de ne pas le respecter.
Ces allégations sont principalement rapportées dans des ouvrages chiites anciens, notamment :
- Le livre « Fasl al-khitab fi tahrif kitab rabb al-arbab » de Mirza Houssayn Muhammad Taqui an-Nouri at-Tabrassi (mort en 1320 H).
- Le « Dabistan Madhahib » de Mulsin Fani al-Kashnirri.
Bien sûr, cette vision des choses est rejetée par les Sunnites : les passages contentieux concernent très précisément les désaccords entre chiites et sunnites. Et au sein même des chiites, le consensus ne règne pas. Néanmoins il s’agit d’une revendication soutenue par de très nombreux croyants dont je n’ai aucune raison de penser qu’ils sont de moins bons musulmans que les autres.
Il en résulte deux alternatives :
- Deux sourates ont été si bien imitées que des islamologues, des spécialistes arabophones du coran sont convaincus qu’elles font partie du texte original.
Ou bien
- Ces sourates sont vraies, mais ont été supprimées. Et alors nous nous retrouvons devant un Coran modifié par les hommes qui ne peut plus être considéré comme divin car on ne sait pas quelles autres changements lui ont été apportés.
Il faut donc choisir entre un Coran imité ou un Coran corrompu.
— Le Coran est pire qu’incohérent, il est injuste ! —
Le Coran contient plusieurs passages où Allah empêche les mécréants de croire, souvent accompagnés de menaces de punition. Voici les principaux :
Sourate 2, verset 7 : « Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles; et un voile épais leur couvre la vue; et pour eux il y aura un grand châtiment. »
Sourate 6, verset 25 : « Il en est parmi eux qui viennent t’écouter, cependant que Nous avons mis des voiles sur leurs cœurs, pour qu’ils ne comprennent pas, et une lourdeur dans leurs oreilles. Quand même ils verraient toutes sortes de preuves, ils n’y croiraient pas. »
Sourate 7, verset 179 : « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d’hommes pour l’Enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n’entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. »
Sourate 17, verset 46 : « Nous avons mis des voiles sur leurs cœurs, de sorte qu’ils ne le comprennent pas: et dans leurs oreilles, une lourdeur. Et quand, dans le Coran, tu évoques Ton Seigneur l’Unique, ils tournent le dos par répulsion. »
Sourate 18, versets 100-102 : « Et ce jour-là Nous présenterons de près l’Enfer aux mécréants, dont les yeux étaient couverts d’un voile qui les empêchait de penser à Moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Ceux qui ont mécru, comptent-ils donc pouvoir prendre, pour alliés, Mes serviteurs en dehors de Moi? Nous avons préparé l’Enfer comme résidence pour les mécréants. »
Ces versets montrent qu’Allah lui-même empêche certains de croire en « scellant leurs cœurs » ou en mettant des « voiles » sur leurs cœurs et leurs oreilles, tout en promettant un châtiment sévère pour leur incroyance.
J’ai demandé à Ousmane TIMERA : « Admettons que j’ai le pouvoir de vous forcer à commettre un acte interdit. Une fois que vous l’avez fait, je vous punis sévèrement. Est-ce juste ? » Et je n’ai obtenu en réponse qu’une salade de mots, car mon interlocuteur est dans l’incapacité d’admettre que Dieu soit injuste.
— Le coran a été abrogé —
Le Coran se présente comme un texte immuable et éternel, incréé, destiné à guider l’humanité depuis sa révélation jusqu’à la fin des temps, couvrant ainsi toutes les époques de l’histoire humaine. Toute abrogation est alors illogique. On ne peut envisager qu’il soit abrogé par les hommes, bien sûr, ni même par Dieu qui est omniscient et qui a des ressources infinies pour ne faire descendre que des propos valables en tous temps, puisque la clarté et la simplicité sont des qualités que le texte revendique.
Mais si c’est un texte banalement humain au service des ambitions du gourou qui prétend entendre Dieu, alors les abrogations sont des évènement auxquels on peut s’attendre. Et de fait…
Coran 2:106 : « Si Nous abrogeons un verset quelconque ou que Nous le fassions oublier, Nous en apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu’Allah est Omnipotent ? »
Coran 16:101 : « Quand Nous remplaçons un verset par un autre – et Allah sait mieux ce qu’Il fait descendre – ils disent : « Tu n’es qu’un menteur ». Mais la plupart d’entre eux ne savent pas. »
Coran 22:52 : « Nous n’avons envoyé, avant toi, ni Messager ni prophète qui n’ait récité (ce qui lui a été révélé) sans que le Diable n’ait essayé d’intervenir [pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet] de sa récitation. Allah abroge ce que le Diable suggère, et Allah renforce Ses versets. Allah est Omniscient et Sage. »
L’abrogation du Coran par le Coran est un fait consensuel dans les écoles islamiques.
— Versets équivoques : le coran n’est pas clair —
Nous trouvons dans le texte la prétention que le texte est simple, « dénué de tortuosité », autrement dit le Coran doit être clair, lisiblement, univoque.
Sourate 39 :27 « Nous avons, dans ce Coran, cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu’ils se souviennent.
28 Un Coran [en langue] arabe, dénué de tortuosité, afin qu’ils soient pieux ! »
Mais dans le même texte, on nous dit que des fois, c’est différents. Cette règle absolue est finalement relative, donc fausse. Si vous trouvez des verset tortueux ou ambigus, c’est que vous faites preuve de mauvaise volonté comme stipulé dans la sourate 3 :
Sourate 3:7 : C’est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre : il s’y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du Livre, et d’autres versets qui peuvent prêter à d’interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l’égarement, mettent l’accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n’en connaît l’interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent : « Nous y croyons : tout est de la part de notre Seigneur! » Mais, seuls les doués d’intelligence s’en rappellent. »
Autrement dit : le Coran est clair. Mais par endroit, seul Allah connait le sens de ce qu’il dit. Cela m’inspire deux questions :
- Comment reconnait-on un passage dont le sens réel est caché et connu seulement de Allah ?
- A quoi servent de tels passages dans un texte dont le but est de rendre les gens pieux ?
Sourate 39 :27 « Nous avons, dans ce Coran, cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu’ils se souviennent.
28 Un Coran [en langue] arabe, dénué de tortuosité, afin qu’ils soient pieux ! »
J’ai posé ces deux questions avec insistance lors du débat.
— Les erreurs et les incohérences dans le coran —
On pourrait faire une liste interminables des erreurs et incohérences dans le texte. Majid Oukacha l’a fait dans son livre « 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran » (2023).
Je vais en présenter certaines en sachant très bien que la tradition coranique a imaginé toutes sortes de parades. En définitive elles consistent toutes à dire que le lecteur critique ne comprend pas ce qu’il lit, que la traduction est fautive, qu’il faut toujours chercher ailleurs un sens différent aux mots employés, afin de lire dans ces phrases des messages acceptables selon nos critères scientifiques et moraux actuels. Cette danse du ventre fait des merveilles auprès des endoctrinés qui peuvent se rassurer à la fermeté avec laquelle les doctes défenseurs de la foi prétendent que ces problèmes sont résolus ; leur dissonance cognitive est soulagée. Mais les croyants ne sont pas des gens stupides, et beaucoup se rendent compte que les réponses ne sont pas à la hauteur, notamment car elles consistent à affirmer que le Coran est si mal écrit qu’il faut le défendre à grands renforts d’interprétations oiseuses.
Ci-dessous je ne vais pas me contenter de pointer des faiblesses dans le texte, je vais me permettre de lui apporter des corrections. Je vais écrire des phrases qui, si elles venaient du 7e siècle, seraient de nature à réellement impressionner les non croyants, mais que Mohammed n’était pas capable d’écrire. Et pourtant je ne vais utiliser que des notions disponibles à cette époque.
Création en six jours ou huit jours ?
- Une première version de l’histoire de la création parle de Six jours : « Votre Seigneur est Dieu, qui créa les cieux et la Terre en six jours » (Sourate 7:54, Sourate 10:3, Sourate 25:59).
- Une autre parle de huit jours : « Il a créé la Terre en deux jours (…), puis il y établit des montagnes en quatre jours (…), ensuite Il acheva en deux jours la création des cieux » (Sourate 41:9-12).
Amélioration proposée : « La création a connu plus de siècles que les hommes n’ont connu de jours sur la Terre. »
Cela permet de donner un âge à l’univers sans borner l’acte de création lui-même. La science nous apprend que les humains ont environ 300.000 ans. Cette phrase donne donc à l’univers un âge supérieur 10,95 milliards d’années. C’est une information qui date du 20e siècle. Actuellement l’estimation est de 13,77Ga. Par ailleurs, pour rétablir l’ordre dans la genèse qui mélange l’apparition des plantes et du soleil, et place la création du ciel à la fin (c’est ballot) on peut améliorer avec cette phrase : « La Terre est devenue un jardin après avoir pris forme sous la lumière du soleil, étoile parmi les étoiles. »
Le soleil se couchant dans une source boueuse ?
Sourate 18:86 « Il suivit une voie, jusqu’à ce qu’il atteigne le lieu où le soleil se couche, et il le trouva se couchant dans une source boueuse »
Amélioration proposée : « Et il vit qu’autour du Soleil, le mouvement de la Terre donnait l’illusion qu’il se lève et se couche, mais Allah vous révèle la vérité sur l’ordre du ciel. »
Partout dans le Coran la Terre est immobile, ce qui correspond aux croyances de l’époque. Un texte divin aurait apporté cette connaissance, « afin qu’ils soient pieux ! »
La Terre est plate ?
Non seulement la Terre est immobile, conformément au 7e siècle, mais à plusieurs reprises le texte la présente comme une étendue plate. Soit la langue était trop pauvre pour le message de Dieu qui avait à sa disposition d’autres peuples et d’autres langues mieux adaptées, soit… Mohammed a fait ce qu’il pouvait avec ses connaissances de bédouin.
Sourate 15 : 19 « Et quant à la terre, Nous l’avons étalée et y avons placé des montagnes (immobiles) et y avons fait pousser toute chose harmonieusement proportionnée. »
Sourate 71, verset 19 «Et c’est Allah qui vous a assigné la terre comme tapis (étalé)» (Le mot arabe « bisatan » utilisé ici signifie « tapis » ou « étalé », suggérant une surface plane.)
Sourate 78, verset 6 « N’avons-nous pas désigné la terre plate [et sans obstacle] » (Le terme arabe « mihadan » est utilisé, signifiant « plat » ou « aplati ».)
Sourate 79, verset 30 : « Et la terre/planète Terre après qu’il souffla dessus et l’étala. » (Le verbe « dahaha » est utilisé, généralement traduit par « étaler » ou « étirer ».)
Sourate 88, verset 20 : « Et la Terre, comme elle est nivelée ? »
Amélioration proposée : « La terre est ronde et si grande que les plus hautes montagnes semblent écrasées lorsqu’on les voit du ciel. Les continents se déplacent lentement, et leurs mouvements érigent les montagnes. Allah est savant »
Origine des spermatozoïdes : la colonne vertébrale ?
Quand le Coran explique comment l’homme vient à la vie, sa biologie n’est même pas approximative, il ne fait aucun effort.
Sourate 86:6-7 « Il a été créé d’une giclée d’eau jaillissante qui sort d’entre les lombes et les côtes »
Amélioration proposée : « Il a été créé pour moitié d’une substance venue des testicules et s’associant avec l’œuf minuscule dans le ventre de la femme. »
Le texte pourrait même préciser que les femmes contribuent davantage en termes de génétique ; elles fournissent l’ADN mitochondrial. Il était facile de révéler en des mots du 7e siècle certains mécanismes de l’hérédité, et ainsi nous disposerions d’un miracle du Coran capable d’impressionner les biologistes les plus mécréants
Erreurs mathématiques dans l’héritage ?
Les règles de l’héritage (Sourate 4:11-12) attribuent des fractions qui, dans certains cas, dépassent 100 % du patrimoine.
- Problème : Par exemple, si un homme laisse deux filles (elles reçoivent 2/3), ses parents (ils reçoivent 1/3) et son épouse (elle reçoit 1/8), la somme des parts est supérieure à 1.
Amélioration proposée : N’importe quelle distribution qui ne dépasse pas 100% des biens du défunt. Eventuellement une distribution qui ne réduit pas les femmes à recevoir presque toujours moins que les hommes. On peut aussi imaginer que le texte divin concentre ses pages limitées à des choses plus importantes pour l’humanité que de régir les questions d’héritage. Il pourrait parler d’éducation et d’ouverture d’esprit, par exemple. Cela améliorerait ce texte imparfait.
— L’argent du gourou —
Le Coran mentionne à plusieurs reprises le versement de biens au Prophète Mohammed, principalement dans le contexte du butin de guerre. Voici les principales références :
Sourate Al-Anfal (8), verset 41 : « Et sachez que, de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, au Messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs (en détresse) »
Sourate Al-Hashr (59), verset 7 : « Le butin provenant [des biens] des habitants des cités, qu’Allah a accordé sans combat à Son Messager, appartient à Allah, au Messager, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et au voyageur en détresse. »
Sourate Al-Ahzab (33), verset 50 : « Ô Prophète! Nous t’avons rendu licites tes épouses à qui tu as donné leur mahr (dot), ce que tu as possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu’Allah t’a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, – celles qui avaient émigré en ta compagnie, – ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle: c’est là un privilège pour toi, à l’exclusion des autres croyants ».
C’est exactement le genre de choses qu’on s’attend à trouver dans un texte imaginé par Mohammed pour servir ses propres intérêts aux dépens d’un groupe de crédules. Un texte divin n’aurait pas de raison d’obliger des transferts de fonds vers la propriété d’un homme, son prophète, qu’il peut bénir de toute sa providence sans intermédiaire : ce serait plus convaincant.
— Les esclaves sexuelles du gourou —
Si le texte n’est pas divin mais inventé par un gourou humain avec les appétits habituels des gourous, on s’attend à ce qu’il s’arroge le droit d’avoir un maximum de partenaires sexuelles.
Sourate 33:50. « Ô Prophète! Nous t’avons rendue licites tes épouses à qui tu as donné leur mahr (dot), ce que tu as possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu’Allah t’a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, – celles qui avaient émigré en ta compagnie, – ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle : c’est là un privilège pour toi, à l’exclusion des autres croyants. Nous savons certes, ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu’ils possèdent, afin qu’il n’eût donc point de blâme contre toi. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »
Le coran, texte universel et éternel passe même un long passage à justifier l’appétit de Mohammed pour la femme de son fils adoptif.
Coran 33:37 et 38. « Quand tu disais à celui qu’Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l’avais comblé : « Garde pour toi ton épouse et crains Allah », et tu cachais en ton âme ce qu’Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c’est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eût cessé toute relation avec elle, Nous te la fîmes épouser, afin qu’il n’y ait aucun empêchement pour les croyants d’épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d’Allah doit être exécuté. Nul grief à faire au Prophète en ce qu’Allah lui a imposé, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d’Allah est un décret inéluctable. »
Comment croire qu’un texte divin et parfait s’abaisse à ce genre de choses ?
— Le Coran a connu des réécritures—
La version définitive du Coran n’a pas été composée et actée à une date unique, mais à travers un processus qui s’est étalé sur plusieurs siècles.
- Sous le calife Othman (644-656), une première version officielle, la « vulgate d’Othman », a été établie et diffusée.
- Cependant, d’autres versions ont continué à circuler après cette première standardisation. Selon Mohamed Ali Amir Moezzi, c’est seulement au IVe siècle de l’Hégire (Xe siècle de l’ère chrétienne) que la version officielle a été largement acceptée[1].
- Sous le règne du calife omeyyade Abd al-Malik (685-705), des modifications importantes ont été apportées au texte, notamment par al-Hajjaj b. Yusuf. Ces changements auraient inclus des améliorations orthographiques et possiblement une réorganisation des versets et des sourates[2].
- Certains chercheurs, comme John Wansbrough, estiment que le texte coranique n’a pris sa forme définitive qu’à la fin du VIIIe siècle, voire au début du IXe siècle.
- François Déroche, spécialiste des manuscrits coraniques, suggère que le processus de stabilisation du texte s’est poursuivi sous les Omeyyades et les Abbassides, aboutissant à un texte stable dont les éléments fondamentaux sont présents dans les manuscrits les plus anciens[3].
En somme, bien que la tradition musulmane attribue la fixation du texte coranique à Othman au VIIe siècle, les recherches historiques indiquent que le processus de composition et de stabilisation de la version définitive du Coran s’est étendu sur plusieurs siècles, probablement jusqu’au IXe ou Xe siècle.
[1] Anne-Sylvie Boisliveau, Le Coran par lui-même. Vocabulaire et argumentation du discours coranique autoréférentiel, Leiden, Brill, 2014, 432 p. https://journals.openedition.org/assr/26326
[2] Claude Gilliot (2008) . Origines et fixation du texte coranique. Études, Tome 409(12), 643-652. https://doi.org/10.3917/etu.096.0643. https://shs.cairn.info/revue-etudes-2008-12-page-643?lang=fr
[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Approches_traditionnelles_de_la_transmission_du_Coran
CONCLUSION
Nous sommes tous conduits à suivre notre raison, nous avons tous intérêt à ce que chacun se questionne sur ce qu’il croit être vrai et accepte que ses hypothèses soient testées et ses croyances discutées si nous voulons nous débarrasser des idées fausses que nos cerveaux imparfait peuvent concevoir. Les débats sont des occasions de s’exposer à des visions du monde différentes dont nous pouvons évaluer les mérites. Nous devrions avoir envie de méditer sur un fait limpide : l’humanité n’a jamais souffert d’un excès de questionnement, de prudence épistémique, de nuance et de rationalisme.
Acermendax